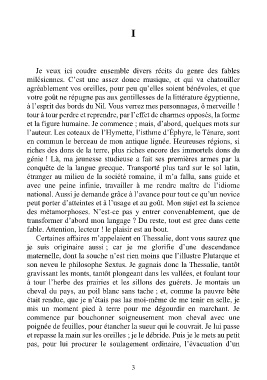Page 3 - L'ane d'Or - auteur : APULEE- Libre de droit
P. 3
I
Je veux ici coudre ensemble divers récits du genre des fables
milésiennes. C’est une assez douce musique, et qui va chatouiller
agréablement vos oreilles, pour peu qu’elles soient bénévoles, et que
votre goût ne répugne pas aux gentillesses de la littérature égyptienne,
à l’esprit des bords du Nil. Vous verrez mes personnages, ô merveille !
tour à tour perdre et reprendre, par l’effet de charmes opposés, la forme
et la figure humaine. Je commence ; mais, d’abord, quelques mots sur
l’auteur. Les coteaux de l’Hymette, l’isthme d’Éphyre, le Ténare, sont
en commun le berceau de mon antique lignée. Heureuses régions, si
riches des dons de la terre, plus riches encore des immortels dons du
génie ! Là, ma jeunesse studieuse a fait ses premières armes par la
conquête de la langue grecque. Transporté plus tard sur le sol latin,
étranger au milieu de la société romaine, il m’a fallu, sans guide et
avec une peine infinie, travailler à me rendre maître de l’idiome
national. Aussi je demande grâce à l’avance pour tout ce qu’un novice
peut porter d’atteintes et à l’usage et au goût. Mon sujet est la science
des métamorphoses. N’est-ce pas y entrer convenablement, que de
transformer d’abord mon langage ? Du reste, tout est grec dans cette
fable. Attention, lecteur ! le plaisir est au bout.
Certaines affaires m’appelaient en Thessalie, dont vous saurez que
je suis originaire aussi ; car je me glorifie d’une descendance
maternelle, dont la souche n’est rien moins que l’illustre Plutarque et
son neveu le philosophe Sextus. Je gagnais donc la Thessalie, tantôt
gravissant les monts, tantôt plongeant dans les vallées, et foulant tour
à tour l’herbe des prairies et les sillons des guérets. Je montais un
cheval du pays, au poil blanc sans tache ; et, comme la pauvre bête
était rendue, que je n’étais pas las moi-même de me tenir en selle, je
mis un moment pied à terre pour me dégourdir en marchant. Je
commence par bouchonner soigneusement mon cheval avec une
poignée de feuilles, pour étancher la sueur qui le couvrait. Je lui passe
et repasse la main sur les oreilles ; je le débride. Puis je le mets au petit
pas, pour lui procurer le soulagement ordinaire, l’évacuation d’un
3